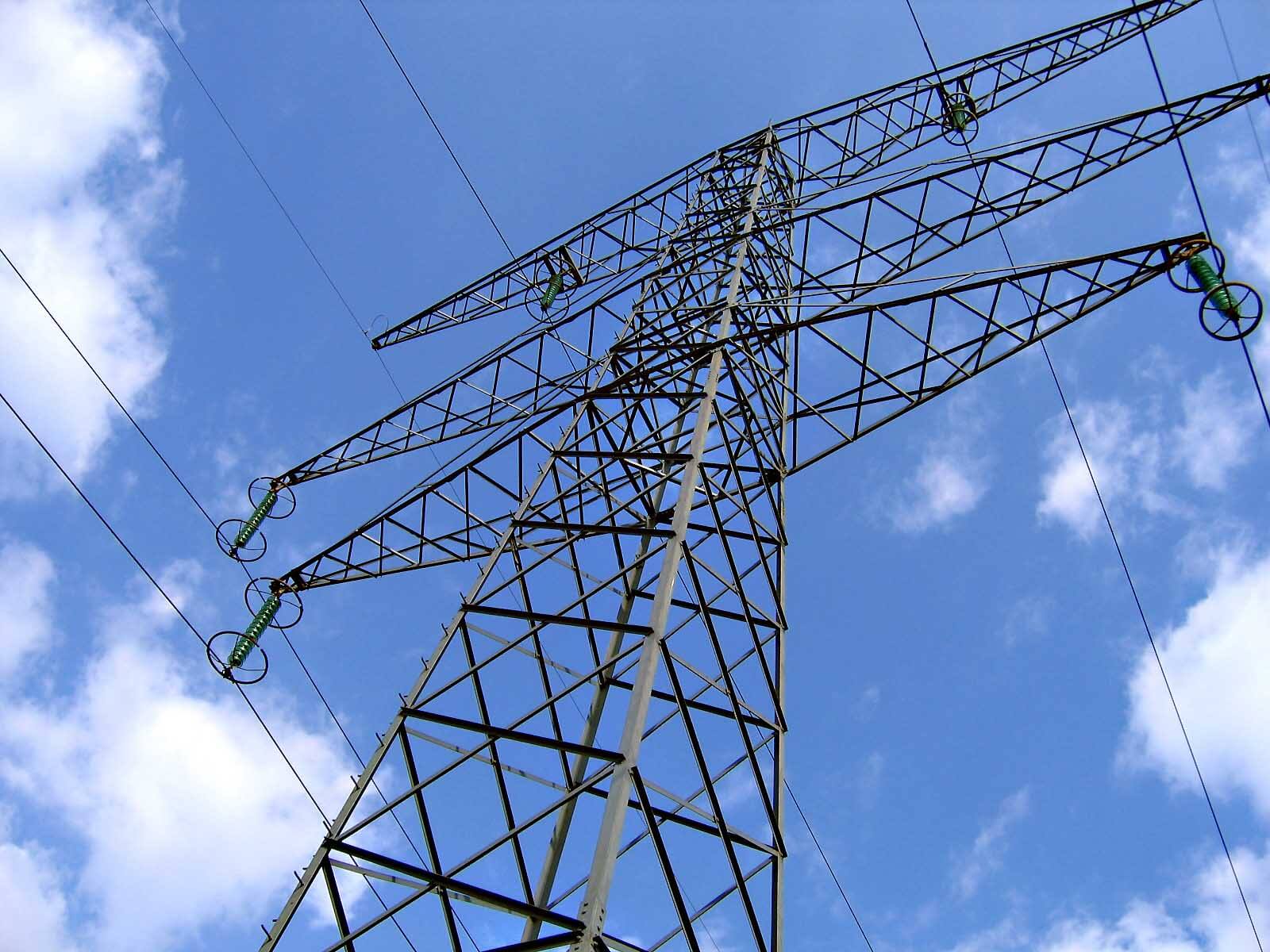L’augmentation généralisée et à des niveaux sans précédents depuis près d’un siècle des droits de douane par l’administration Trump et les mesures de rétorsion annoncées ou à venir des pays frappés vont avoir de lourdes conséquences, selon la quasi-totalité des économistes, sur l’économie mondiale. A savoir, provoquer des récessions, notamment aux Etats-Unis avec 60% de probabilité que cela se produise selon la banque JP Morgan, et paradoxalement créer dans le même temps de l’inflation. La recette parfaite de la fameuse stagflation tant redoutée. Mais la hausse des prix pourrait être contrebalancée, au moins en partie, par la dégringolade, le mot est faible, des prix du pétrole. On peut même parler de mini krach. Pas l’équivalent d’avril 2020, au plus fort de la pandémie de Coronavirus, mais un vrai choc tout de même.
Pour l’Europe, la chute libre des cours du pétrole et surtout dans la foulée de ceux du gaz naturel, tombés à leurs plus bas niveaux depuis six mois, est plutôt une bonne nouvelle dans un océan de craintes. Cela permettra au moins de reconstituer des stocks de gaz tombés à des niveaux très bas du fait d’un hiver assez rigoureux plus facilement. Le TTF néerlandais, est tombé à 36,4 euros le mégawattheure (MWh), au plus bas depuis septembre dernier.
Chute libre
Mais ce n’est rien à côté de la dégringolade des cours du pétrole. Depuis l’annonce d’une politique économique radicalement protectionniste par Donald Trump lors de sa « journée de la libération », ils se sont littéralement effondrés… Ils ont perdu environ 12 dollars pour revenir à leurs niveaux d’avril 2021, au moment de la sortie de la récession planétaire résultant de la pandémie de Covid.
Le baril de qualité Brent est ainsi tombé, au plus bas, vendredi 5 avril sous les 65 dollars et avait perdu alors près de 14% en deux jours. Quand au baril de qualité WTI (West Texas Intermediate), il était tombé vendredi à 61 dollars perdant près de 15% en deux jours. Et lundi 7 avril, en début de journée en Asie, la chute libre s’est poursuivie, le Brent s’échangeant alors à un peu plus de 63 dollars et le WTI à moins de 60 dollars. Depuis la « journée de la libération », la dégringolade des cours du pétrole est de l’ordre de 17%.
L’Opep+ à contretemps
Si les produits énergétiques ont bien été exemptés de droits de douane par la Maison Blanche, leurs prix sont directement conditionnés par le niveau de la demande et donc la conjoncture. L’activité économique peut se résumer à 99% à des transferts d’énergie…
Il faut aussi ajouter à cette situation, la décision, prise au plus mauvais moment possible, d’une augmentation plus rapide que prévue de sa production par le cartel Opep+. Rappelons que l’Opep+ regroupe les 13 pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole historique, menée par l’Arabie Saoudite, et leurs 10 alliés (le +) menés par la Russie.
Le cartel va « mettre en œuvre un ajustement de la production de 411.000 barils par jour en mai 2025 », a-t-il annoncé le 3 avril. Le marché anticipait une augmentation de 135.000 barils par jour en mai, conformément au calendrier annoncé de retour progressif sur le marché en 18 mois des 2,2 millions de barils quotidiens que le cartel avait décidé de ne pas produire. La décision d’accélérer les choses n’a strictement rien à voir avec la conjoncture et les décisions de la Maison Blanche et tout à voir avec des problèmes internes à l’organisation et la frustration de certains pays face à ceux qui ne respectent pas leurs quotas. En clair, l’Arabie Saoudite a perdu patience et a décidé de tripler l’augmentation de sa production en mai pour « punir » des pays comme le Kazakhstan ou l’Irak qui ne respectent pas leurs engagements.
Surabondance de pétrole
Pour résumer, même si les embargos sur le pétrole iranien, vénézuélien voire russe sont renforcés et plus efficaces, ce qui reste à voir, l’avenir immédiat est plutôt celui d’une surabondance de pétrole par rapport à une demande en berne. UBS qui prévoyait au début de l’année que la demande mondiale augmenterait de 1,1 million de barils par jour a réduit maintenant cette prévision de près de moitié. Et cela ne pourrait être qu’un début.
« La riposte agressive de la Chine à l’augmentation brutale des droits de douane américains confirme que nous nous dirigeons vers une guerre commerciale mondiale. Une guerre qui n’aura pas de gagnant et qui nuira à la croissance économique et à la demande de matières premières essentielles telles que le pétrole brut et les produits raffinés », affirme à Reuters Ole Hansen, responsable de la stratégie des matières premières de Saxo Bank. « À ce stade, nous ne sommes pas seulement entrés dans une phase de destruction de la demande, mais aussi dans une phase de destruction de l’offre de la part des producteurs à coûts élevés, ce qui, avec le temps, contribuera d’ailleurs à amortir la chute», ajoute-t-il.
Même le Fonds monétaire international (FMI) a manifesté son inquiétude sur la croissance mondiale. « Nous sommes encore en train d’analyser les conséquences macroéconomiques des mesures douanières annoncées, mais il est manifeste qu’elles font peser un risque important sur les perspectives internationales dans un contexte de croissance atone. Il est important d’éviter des décisions susceptibles de nuire davantage à l’économie mondiale », a déclaré sa Directrice générale, Kristalina Georgieva. Il faut dire qu’il faut remonter au 17 juin 1930 pour trouver l’équivalent du « jour de la libération » avec la promulgation alors aux États-Unis de la loi Hawley-Smoot, du nom de deux élus républicains du Congrès, qui augmentait fortement les droits de douane sur plus de 20.000 marchandises importées. On connait la suite…
« Drill, Baby Drill »… déjà de l’histoire ancienne
Pour en revenir au pétrole, le slogan historique républicain en faveur de l’industrie pétrolière, repris lors de sa campagne par Donald Trump, « Drill, Baby Drill » (Fore, chéri fore), n’est pas prêt de devenir une réalité. Quelle ironie de l’histoire ! Le retour à la Maison Blanche de Donald Trump a été considéré comme une victoire majeure pour les compagnies pétrolières, notamment américaines. Elles allaient retrouver une totale liberté pour chercher et exploiter des hydrocarbures presque partout sur le sol américain et dans le même temps la politique de transition énergétique mise en place par l’administration Biden allait être démantelée. Ce que peu d’experts imaginaient est que la politique économique du Président des Etats-Unis allait se traduire par un effondrement des cours du baril et donc de la rentabilité des groupes pétroliers… Dans ces conditions, investir n’a pas beaucoup de sens.
Les contrats à terme sur le pétrole américain sont tombés à 61 dollars le baril vendredi 4 avril. Ils se trouvent bien en dessous du seuil de 65 dollars considéré comme le niveau minimum pour exploiter de façon rentable de nouveaux puits au Texas et dans les États voisins, selon une enquête récente de la Federal Reserve Bank de Dallas. Et dans le même temps, depuis que Donald Trump a imposé le mois dernier des droits de douane de 25% sur l’acier importé, le prix des équipements de forage s’est envolé.
Et l’Opep+ n’est pas non plus à la fête. La quasi-totalité des pays membres du cartel ont besoin de cours du pétrole élevés pour couvrir leurs dépenses publiques. Pour l’Arabie saoudite et selon le FMI, il faut que ses barils se vendent au moins à 90 dollars. Comme ce n’est pas le cas, le royaume a déjà été contraint de réduire les investissements dans certains des projets au cœur de la vision du prince héritier Mohammed ben Salman pour transformer son économie. L’Irak a également besoin de prix supérieurs à 90 dollars le baril et le Kazakhstan a plus de 115 dollars le baril, toujours selon le FMI.