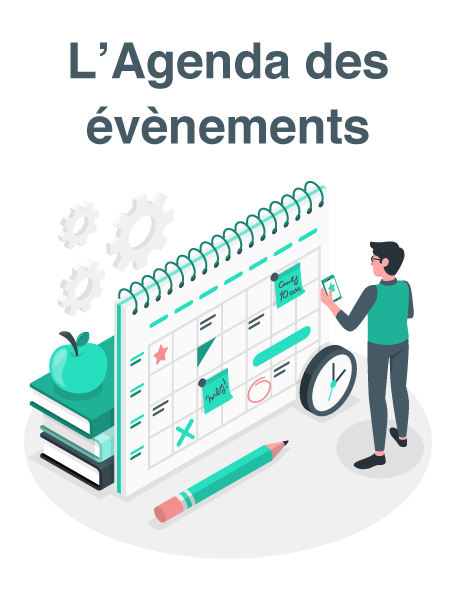En mars 2021, la China Development Bank a annoncé une nouvelle émission d’obligations «vertes», à hauteur de 3 milliards de dollars américains, pour financer ses programmes de soutien aux énergies renouvelables. La Caisse des Dépôts française émet, de son côté, des obligations labellisées vertes, sociales et durables, présentées comme particulièrement innovantes, qui doivent accompagner l’évolution de la société française vers un modèle économique bas-carbone tout en réduisant les fractures de la société.
Ainsi se déroule le volet financier de la transition économique, environnementale et sociétale, dont l’objectif est de mettre la pédale douce sur les projets dont les dommages collatéraux à long terme sont supérieurs aux bénéfices à court terme. Ne plus financer les uns, orienter les financements vers les autres, c’est toute la promesse des financements «verts», obligations «vertes» et investisseurs à impact.
Il devrait être question de cette finance verte à la 26e Conférence des parties pour le climat (CP206), qui se déroule du 31 octobre au 12 novembre à Glasgow (Royaume-Uni): la finance doit se transformer et encourager les projets qui favorisent la transition, concentrer les financements vers les projets vertueux, et tarir les sources de financements pour les projets préjudiciables. C’est le sésame financier de la transition.
Seulement 5% de l’investissement mondial
Pourtant, le constat est que les effets des financements verts ne sont pas notables sur les courbes des émissions de gaz à effet de serre, ni sur la perte des espaces naturels qui entraîne l’extinction accélérée des espèces animales et végétales. Le dernier rapport de l’IEA (International Energy Agency), produit conjointement avec la Banque mondiale et le World Economic Forum, est sans appel: les intentions positives ne se voient pas dans les faits. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun problème de financement, seulement 150 milliards sont investis dans les renouvelables chaque année, quand la seule exploration pétrolière engloutit en moyenne 500 milliards par an.
Les scientifiques alertent, à intervalle régulier, sur l’insuffisance des résultats. Selon toute vraisemblance, la décennie qui nous mène à 2030 ne permettra pas d’attendre les objectifs du développement durable. Il est en particulier probable que les émissions de gaz à effet de serre continueront d’augmenter.
Il y a donc un problème dans l’équation, et ce problème interpelle la crédibilité et l’organisation de la finance verte partout dans le monde.
Le premier constat est volumétrique. Selon l’organisation internationale Climate bonds initiative, le marché des obligations vertes aurait franchi la barre de 1.000 milliards de dollars d’émissions annuels en 2020. Cela peut paraître considérable, mais ce n’est que 5% de l’investissement mondial et une petite fraction du marché mondial des obligations, qui atteint 128.300 milliards de dollars.
Le monde financier renâcle donc à passer plus franchement à l’action. Mais pourquoi? Trois explications peuvent être avancées: d’abord, les incitations à agir restent des signaux faibles, voire très faibles, et les «décisions sans retour» des gouvernements sont trop peu nombreuses. Ensuite, la finance n’est pas encore structurée pour gérer une complexité et des impacts dont la mesure ne se traduit pas directement en prix et en profits. Enfin, les normes et standards sont imprécis et par voie de conséquences peu contraignants: chacun verdit un peu ce qu’il veut.
Les incitations réelles n’existent pas
Du point de vue des banquiers, il faut bien convenir que les gouvernements, les marchés et leurs régulateurs ne traduisent pas encore en système de contraintes ou d’incitations l’utilisation des instruments de la finance verte. De même, les systèmes de prix auxquels les banques sont confrontées restent déterminés par des marchés qui sont indifférents aux limites souhaitables des émissions de CO2.
Il n’y a toujours pas de véritable taxe carbone, le système fiscal reste biaisé en faveur d’activités émissives (comme le subventionnement du carburant aérien et agricole), les primes d’assurances restent largement indifférentes aux risques des actifs échoués. Il n’y a actuellement aucune «prime de rendement» sur les financements verts, pas plus qu’il n’y a de pénalités pour ceux qui ne le sont pas.
Il s’agit encore, pour l’essentiel, de faire appel à une certaine éthique de l’environnement, dans le cadre de diligences qui se limitent aux principes de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Si ces éléments, sans aucun doute, peuvent fonder une communication d’entreprise, voire certains choix philanthropiques, ils n’ont toutefois, jusqu’à preuve du contraire, jamais été des guides dans les choix d’allocations des actifs financiers des banques.
Ne pas nuire, donc, mais selon des normes qui restent loin d’une prise en compte des biens publics mondiaux non exclusifs comme le climat, ou de principes de solidarité transfrontalière ou intergénérationnelle. Les injonctions ne se transforment ni en règlements ni en prix, qui sont pourtant les seules réalités économiques et financières tangibles pour le système financier.
La différence entre «ne pas nuire» et «bien faire»
Un financement vert se concentre sur la labellisation d’un objet final. Est «vert» un champ d’éolienne ou de panneaux solaires. Cela ne dit rien, naturellement, de la chaîne de valeurs, des consommations intermédiaires et des réseaux de sous-traitance qui ont été mis en jeu. En l’absence de «coût climat» complet, il est par exemple impossible de savoir quel est l’impact émissif véritable d’un bien ou d’un service particulier. Cette absence de connaissance du «prix environnemental et social» des biens et services financés est le nœud d’une complexité que les financements verts ne peuvent pas décrypter.
Il existe aussi une certaine confusion entre la responsabilité sociale et environnementale (RSE) et la transition vers l’agenda 2030. La différence entre «ne pas nuire» et «faire bien» est ténue et souvent mal comprise. C’est la différence entre le repérage des externalités négatives et leur compensation, souvent prévue par la loi, par rapport à des projets conçus pour produire des externalités positives au-delà du périmètre économique de l’entreprise.
En parallèle, s’ils ne sont compris que comme un catalogue, les Objectifs du développement durable (ODD) adoptés par les Nations unies en 2015 ne sont pas vraiment opérants comme critères pour favoriser la transition. Si l’on prend en exemple la mise en culture de nouvelles terres, on pourra enregistrer des impacts très positifs sur la nutrition et la pauvreté, et dans le même temps, constater les préjudices liés à la destruction d’espaces naturels.
Les interactions entre les ODD, entre les questions environnementales et sociales, constituent le sujet essentiel pour juger de l’impact global et à long terme d’un investissement. C’est une matière de complexité, qui est la clé de la transition, et sur laquelle la recherche est attendue pour en éclairer les cohérences comme les limites.
Chacun invente des normes qui l’arrange
Comme nous l’avons évoqué plus haut, le vocable «vert» est accolé à tout investissement qui se caractérise par une diminution de la pollution. Les transports urbains électriques, les traitements de déchets, l’épuration des eaux usées, les énergies renouvelables entrent dans cette catégorie. L’Union européenne a réalisé une taxonomie très complète et très technique pour aider les investisseurs à naviguer vers une transition bas-carbone.
Pourtant, l’analyse des impacts montre qu’un financement «vert» ne l’est pas toujours si l’on prend en compte l’intégralité des impacts. On peut l’illustrer avec l’exemple des transports urbains électriques, identifiés comme «verts», tandis que l’électricité additionnelle nécessaire peut provenir de sources énergétiques très émissives.
Dans un univers où chacun invente un peu la norme qui l’arrange, il est difficile de garantir que les critères utilisés par les émetteurs d’obligations vertes prennent réellement en compte tous les éléments intermédiaires, et ne privilégie pas seulement l’objet final.
L’absence de normes universelles, paradoxalement, induit aussi pour les banques un risque d’image. Attirer l’attention sur les financements verts, c’est aussi prendre le risque d’être scruté et dénoncé comme «greenwasher». Tant que le flou sera la norme, la cohérence, la transparence, l’exemplarité et la lisibilité des impacts des financements resteront questionnées. Et le risque est grand que les financements «marrons» restent la norme, avec en pointillé quelques exceptions vertes pour l’affichage.
Dans un article récent sur Susan Neiman publié dans ces mêmes colonnes, la grande sociologue nous rappelait que
«L’expérience cardinale du devenir adulte est la prise de conscience du gouffre qui sépare «ce qui est» de «ce qui devrait être».»
La finance adulte, durable, c’est peut-être celle qui acceptera de continuer à vivre un pied dans le réel, mais aussi un pied dans l’idéal, en ayant compris qu’une importance égale doit être donnée à ces deux ambitions pour contribuer à façonner un futur souhaitable?
Régis Marodon Conseiller senior sur la finance durable, Agence française de développement (AFD)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.