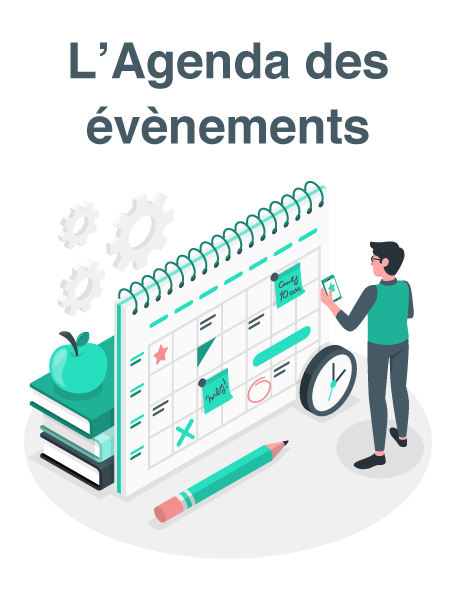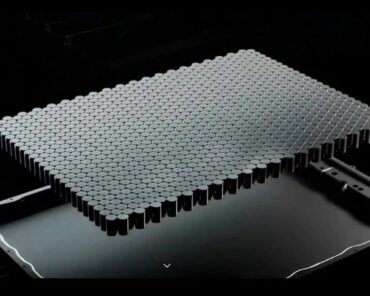Au début de son premier mandat en 2009, le président des États-Unis Barack Obama soutient le projet d’une ligne ferroviaire à grande vitesse entre Los Angeles et San Francisco. Face à des coûts de réalisation jugés exorbitants (estimés de l’ordre de 50 à 60 milliards de dollars à l’époque), le célèbre homme d’affaires Elon Musk se montre sceptique. En 2013, il propose de substituer au projet un nouveau système qu’il nomme «Hyperloop alpha». Des petites capsules de 2,20 mètres de diamètre qui circuleraient sur coussin d’air dans deux tubes aériens, sous vide, à plus de 1.200 km/h pour un investissement initial estimé à 10 milliards de dollars.
Séduites par ce scénario futuriste, de nombreuses start-up ont tenté de concrétiser l’idée. Près d’une décennie plus tard, les avancées restent cependant limitées. Virgin Hyperloop, alimentée par les deniers de l’entrepreneur britannique Richard Branson, a, certes, fait des essais dans le désert du Nevada, atteignant 387 km/h. En novembre 2020, elle a même transporté des passagers pour la première fois, à 172 km/h, mais c’était avant d’annoncer sa reconversion dans le fret. Le tronçon qui devait voir le jour en 2020 pour l’exposition universelle de Dubaï n’est, lui, toujours pas sorti de terre.
Les contrats, cependant, se multiplient. Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a signé le 21 mars 2022 un accord visant à ouvrir une ligne entre Venise et Padoue, en Italie, pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Au Canada, TransPod a tout récemment réussi à lever 550 millions de dollarspour tenter de relier Calgary à Edmonton. En France, le projet de piste d’essai d’HyperloopTT à Toulouse reste au point mort mais celui de TransPod en Haute-Vienne est en cours de réalisation.
Nous sommes donc encore très loin du but, comme nous l’avons expliqué avec Hervé de Tréglodé dans un article de recherche récent. Les effets d’annonce l’emportent sur les résultats concrets car les défis techniques restent nombreux: celui de la rigidité des tubes installés entre des pylônes à l’air libre; faire que l’air dans les tubes ne franchisse jamais le mur du son ; comprimer et refroidir l’air aspiré… Au point que François Lacôte, ancien directeur technique d’Alstom n’hésite pas à parler d’Hyperloop comme d’une « formidable escroquerie technico-industrielle ».
Au regard critique de l’ingénieur, nous pouvons ajouter quelques considérations économiques en interrogeant la pertinence de ces « pods » que l’on présente parfois comme un « cinquième moyen de transport ». Prendre en compte la vitesse physique ne suffit pas : il est aussi nécessaire de considérer la vitesse économique.
Le temps c’est de l’argent
Les économistes ont montré depuis longtemps l’intérêt des gains de vitesse. En effet, le temps, c’est de l’argent. Les utilisateurs du TGV sont prêts à payer plus cher pour aller plus vite. Mais jusqu’où le surcoût est-il acceptable ? Car l’argent, c’est aussi du temps. Combien de temps de travail sera-t-il nécessaire pour acheter de la vitesse ?
Il s’agit en fait de diviser un trajet en deux temps. Il y a celui effectivement passé à se déplacer, et, auparavant, le temps passé à travailler pour pouvoir se payer le prix du billet de train ou d’avion. Dans cette première période, c’est comme si l’usager se déplaçait à une vitesse économique.
Prenons un exemple. Pour un voyage en Concorde il y a 20 ans (le dernier vol a eu lieu en 2003), le coût était proche d’un euro le kilomètre. Le smic net était à l’époque de 6 euros de l’heure, ce qui donne donc une vitesse économique de 6 km par heure de travail et près de 2 000 heures de travail pour l’aller-retour Paris-New-York. Bref, rien de « supersonique ».
Le constat valait aussi pour un salaire élevé, par exemple 10 fois le smic. La vitesse économique du Concorde n’était alors que de 60 kilomètres par heure alors qu’un vol subsonique coûtant 10 fois moins cher (10 centimes au kilomètre) correspondait à une vitesse économique de 600 km/h (et 60 km/h pour le smicard).
[Plus de 80 000 lecteurs font confiance à la newsletter de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
L’échec commercial des vols supersoniques trouve là son origine : le Concorde n’a pas passé le mur de la vitesse économique. Symétriquement, les succès du transport aérien classique et plus encore des compagnies low cost, dont les billets coûtent en moyenne 5 centimes par kilomètre, sont fondés sur la progression tendancielle de leur vitesse économique.
La grande vitesse physique n’a, en fait, pas d’intérêt lorsque la vitesse économique est faible. Car, lorsque l’on combine deux vitesses (pour calculer ici une « vitesse généralisée »), c’est toujours la plus lente qui pèse le plus lourd dans le calcul.
Prenons l’exemple d’un cycliste qui gravit un col des Alpes à 10 km/h et redescend à 60 km/h pour rejoindre son point de départ. Sa vitesse moyenne n’est pas de 35 km/h (la somme des deux vitesses divisée par deux) mais de 17,1 km/h. Pour les plus mathématiciens, il s’agit d’une moyenne harmonique et non d’une moyenne arithmétique. Le lecteur curieux pourra calculer que même en redescendant le col à la vitesse de la lumière, le cycliste atteint à peine les 20 km/h.
C’est un peu pareil lorsque l’on combine vitesse économique et vitesse physique. La première correspond alors à la montée, la seconde à la descente.
Quels gains de temps et pour qui ?
En nous projetant dans l’imaginaire de Jules Verne, la recherche de vitesse fait rêver. Elle est implicitement considérée comme un signe de progrès, mais parfois au risque d’aller contre le sens commun si la vitesse économique demeure faible pour le plus grand nombre.
La large diffusion des transports ferroviaires puis routiers et aériens a été possible car ils ont permis d’accroître la vitesse de déplacement. Mais le plus grand succès de ces modes de transport, c’est leur démocratisation, laquelle n’a été possible que par une hausse généralisée de la vitesse économique.
Même avec un litre d’essence à 2 euros, une heure de salaire minimum permet aujourd’hui de parcourir environ 100 km avec une petite voiture contre à peine 30 km au début des années 1970. En 1980, un billet d’avion aller-retour vers Tunis nécessitait 123 heures de travail au smic contre 15 en 2020.
Les gains de vitesse physique n’ont pas d’intérêt s’ils ne peuvent être démocratisés. Or les projets de type Hyperloop auront beaucoup de mal à offrir des coûts de déplacement accessibles au plus grand nombre du fait de leur faible débit potentiel.
Par débit, on entend la quantité de voyageurs que l’on peut transporter sur un axe en une heure. Aujourd’hui, dans une rame TGV à deux éléments et deux étages, on peut mettre de 1 000 à 1 200 voyageurs. Avec les systèmes de signalisation modernes, il est possible de faire passer 15 trains par heure et donc 15 000 à 18 000 voyageurs par heure.
Dans des capsules de type Hyperloop, emportant 20 personnes, il faudrait, pour arriver au même résultat, un départ toutes les quatre secondes. Le problème semble insoluble techniquement mais surtout en termes de sécurité. En cas de problème pour une capsule, comment empêcher qu’un certain nombre des suivantes ne viennent s’encastrer dans celle-ci ?
Se polariser sur la vitesse physique ne sert à rien si le débit est faible, alors même que les investissements nécessaires sont gigantesques. Comment justifier des infrastructures coûtant des dizaines de milliards d’euros si elles ne profitent qu’à une minorité de privilégiés ?
On pourrait objecter que la construction du réseau ferroviaire a, elle aussi, demandé des investissements très importants. Au XIXesiècle, un km de voie ferrée coûtait quinze fois plus qu’un km de route. Mais le chemin de fer a permis d’augmenter le trafic de façon telle qu’on a pu amortir les coûts de construction des infrastructures. Dans les années 1970, l’ingénieur Michel Walrave a démontré qu’il en allait de même pour les premiers projets de lignes à grande vitesse.
La question du débit est donc cruciale car elle détermine les coûts privé et public. On touche alors à des questions de nature profondément démocratique. Si l’État finance la construction des infrastructures, comment justifier la mobilisation des impôts de tous pour servir une minorité de privilégiés ? C’est un peu comme si l’on décidait de subventionner les voyages dans l’espace des milliardaires (pour lesquels la vitesse économique est, soit dit en passant, de 100 mètres/h pour un smicard).
Pour Hyperloop, quand bien même une démocratisation serait un jour possible, n’oublions pas que la recherche de vitesse est structurellement confrontée à des rendements décroissants. En doublant la vitesse des trains entre Paris et Lyon, le temps de parcours a été divisé par deux, de 4 à 2 heures. Mais en doublant à nouveau la vitesse (de 250 à 500 km/h), on ne gagnerait qu’une heure et seulement une demi-heure en la multipliant encore par deux (1000 km/h). Le gain en temps serait de plus en plus minime au point que la question se poserait : le jeu en vaut-il la chandelle ? C’est aussi la question à laquelle sont confrontés les projets de type Hyperloop.
Yves Crozet Économiste des transports, professeur émérite à Sciences Po Lyon, Université Lumière Lyon 2
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons Lire l’article original sur The Conversation.