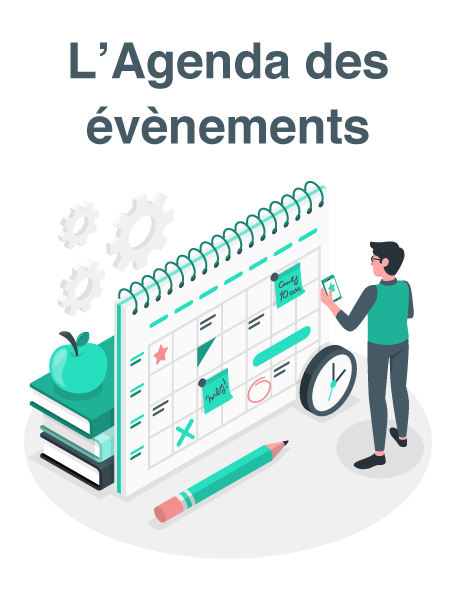Le 8 août 1945, soit deux jours après qu’un avion B-29 américain Enola Gay ait largué la première bombe atomique sur Hiroshima, Albert Camus écrivait dans l’éditorial du journal Combat: «la civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l’utilisation intelligente des conquêtes scientifiques.»
Il n’était pas le seul à être terrifié par le pouvoir d’anéantissement de cette arme nouvelle. Bien d’autres intellectuels français ou étrangers –François Mauriac, Bernard Charbonneau, Lewis Mumford, Gunther Anders ou Michel Serres– ont pensé Hiroshima comme un événement qui marque non seulement la fin de la Seconde Guerre mondiale mais aussi comme un tournant historique tel que le monde d’après ne pourrait plus ressembler au monde d’avant.
Et pourtant le nucléaire militaire et civil s’est installé durablement dans nos sociétés, dans les pays vaincus comme chez les vainqueurs. Le Japon qui a éprouvé la violence soudaine de l’explosion atomique et la violence rampante, sourde et insidieuse, des effets des radiations sur des centaines de milliers de victimes, n’a pas hésité à s’équiper de centrales nucléaires dès les années 1950, résolu à jouir du confort moderne en consommant biens et produits. Et le programme nucléaire national a été soutenu par une grande partie de la population japonaise, y compris parmi les victimes d’Hiroshima et Nagasaki.
Comment comprendre un tel choix technologique quand on a été témoin et victime du potentiel destructeur de l’atome, quand l’électricité abondante et gratuite n’était qu’une promesse alors que les souffrances des victimes des deux bombes étaient une réalité quotidienne ?
En 2011, l’accident de Fukushima venait rappeler la violence des réactions atomiques. Mais cette catastrophe, comme les précédents accidents de Three Mile Island (1979) ou de Tchernobyl (1986), semble à peine avoir ébranlé l’optimisme de l’âge du nucléaire. 75 ans après on peut s’interroger.
Comment l’atome a-t-il pu être pacifié, domestiqué au point de s’inscrire dans les paysages quotidiens et familiers de la France profonde et de pourvoir à la vie ordinaire de nombreux citoyens?
Le poids des mots, des images et des catégories
«Atoms for Peace», ce slogan lancé par le président Eisenhower en 1954, alors même que les États-Unis multipliaient les tests de bombe H dans le Pacifique, a fonctionné comme un mot d’ordre ralliant politiques, scientifiques et ingénieurs pour construire des centrales nucléaires. Il instaure un clivage entre usages guerriers et pacifiques de l’atome.
Comme nombre de ses collègues Frédéric Joliot-Curie a voulu pacifier l’atome, nucléariser la France tout en militant contre les armes nucléaires. L’atome devint ainsi l’archétype des «technologies duales» susceptibles de servir à des fins de guerre comme au mieux-être.
Ce concept suppose que les technologies nucléaires sont intrinsèquement neutres, et que seul l’usage que l’on en fait conduit au bien ou au mal. Durant la Guerre froide, on a pu ainsi justifier la course aux armements, au nom d’un impératif de survie car les méchants sont toujours les «autres».
Cette externalisation permet encore aujourd’hui de dénoncer et contrôler les programmes nucléaires des «États voyous», jugés irresponsables en raison d’intérêts géopolitiques ou de préjugés racistes ou religieux.
Le Peace Memorial Park, inauguré à Hiroshima en août 1955, illustre le pouvoir de clivage du dispositif «technologie duale». Hiroshima est devenu le sanctuaire mondial du pacifisme, point de ralliement des militants pour le désarmement nucléaire. Mais le musée fait silence sur le nucléaire civil. Même après sa rénovation en 2019, il ne dit rien sur Fukushima.
Les images renforcent la dualité inscrite dès l’émergence du nucléaire. Le célèbre champignon atomique est issu de photos Kodak prises lors des tests américains des années 1950 à des fins scientifiques pour étudier l’impact des explosions. Mais cette vision d’apocalypse a été contrebalancée dans l’imaginaire populaire par une image plus sereine et positive, celle de l’Atomium –en fait, un modèle de cristal de fer– à l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958. Le message était clair et presque annonciateur des nanotechnologies: l’atome est une brique pour construire un monde meilleur.
Pour domestiquer la violence propre au nucléaire dans le quotidien il faut encore des trouvailles de gestion administrative. Hibakusha est le terme officiel forgé au Japon pour désigner les personnes victimes des bombardements ou exposées aux radiations consécutives. Depuis 1957, c’est une catégorie juridique dont la définition est sans cesse révisée, pour déterminer qui a droit aux soins médicaux gratuits.
D’autres catégories bureaucratiques délimitent les zones géographiques d’exclusion, en fonction de l’intensité des radiations, pour établir qui a droit à un relogement, à des indemnités ou à un retour.
La banalisation du nucléaire repose donc, en premier lieu, sur des stratégies de démarcation faisant le partage entre bons et méchants, instaurant des seuils de dangerosité et des limites entre zones de sécurité et d’exclusion.
Normaliser et confiner
La banalisation du nucléaire repose également sur un important travail d’experts pour pacifier et contrôler les usages de l’atome. Dans les années 1950, après la concentration sans précédent d’experts au sein du projet Manhattan qui a conduit aux premières bombes, physiciens, chimistes, biologistes et ingénieurs jouissent encore d’investissements massifs pour maîtriser les réactions, choisir les matériaux, mesurer les impacts de la radioactivité sur la faune, la flore, le climat, comme sur la santé humaine.
Ces savoirs experts sont déployés dans un ensemble d’institutions de régulation et de contrôle, la plus célèbre étant l’Agence internationale pour l’Energie Atomique (AIEA). Fondée en 1957 pour promouvoir les usages pacifiques de l’atome tout en freinant les applications militaires, l’AIEA assume une double mission. Elle accompagne le développement du nucléaire civil, offre une aide technique, édicte des règles et des normes. En même temps, elle exerce une surveillance sur la prolifération des armes nucléaires à l’échelle internationale, souvent prise dans des jeux géopolitiques mouvants.
L’étroite surveillance des activités nucléaires s’étend à la production de radio-isotopes pour la recherche biomédicale ou pour le diagnostic et la thérapie. Ces sous-produits bénéfiques des infrastructures nucléaires militaires, «symboles de la promesse humanitaire de l’atome» sont largement médiatisés pour légitimer le nucléaire. En contribuant à sauvegarder des vies, les usages médicaux des radio-isotopes ont signé une forme de rédemption après les effets dévastateurs des bombes.
L’âge du nucléaire inauguré le 6 août 1945 dans une vision d’apocalypse a ainsi en quelque sorte été «civilisé» par les réseaux d’experts, la terreur sacrée faisant place au contrôle de la raison scientifique. Les systèmes nationaux et internationaux de régulation, avec leur production de normes techniques, leur contrôle des installations, leurs réseaux de surveillance de la radioactivité dans l’environnement sont les compagnons indispensables de la nucléarisation du monde.
La maîtrise du nucléaire exige aussi plus directement des mesures techniques de confinement pour empêcher la diffusion de matières radioactives dangereuses. Là encore, les experts sont maîtres à bord. A eux il revient de prévenir les accidents, de déterminer la probabilité d’un risque de fusion des réacteurs.
Quant à la gestion des déchets radioactifs, elle a d’abord été considérée par les experts comme un problème secondaire, facile à résoudre en se débarrassant de ces indésirables résidus de nos prouesses techniques dans la mer ou dans quelque contrée lointaine.
75 ans après l’entrée dans l’ère du nucléaire, aucune solution n’a été trouvée. C’est un problème techno-politique pris en charge par les gouvernements des pays engagés dans l’aventure nucléaire.Depuis sa création en 1979 l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) a établi une typologie des déchets en fonction de leur durée de vie et exploré plusieurs scénarios: l’enfouissement irréversible ou réversible, ou l’entreposage en surface. Mais ces déchets continuent à défier les stratégies de normalisation et de confinement qui ont présidé à la gestion des risques nucléaires.
Ce régime technocratique, souvent autoréférentiel, a néanmoins suscité des protestations dans les années 1970 surtout après l’accident de Tchernobyl.
Si la mise en place de réseaux de contre-expertise a pu altérer l’autorité des experts, elle n’ébranle que très partiellement les institutions garantes de la sûreté et de la sécurité nucléaire. Leur travail se poursuit, se renouvelle, se re-légitimise que ce soit pour prévenir les accidents, gérer leurs conséquences, organiser les activités de démantèlement ou proposer des solutions pour les déchets.
Déni et culture du secret
Le confinement de la radioactivité, des produits de réacteurs ou des déchets, s’accompagne d’un confinement des informations. La mise au secret ou l’invisibilisation d’une partie des activités nucléaires et de leurs effets sont caractéristiques de l’âge du nucléaire. Le silence a été imposé aux victimes d’Hiroshima et Nagasaki pendant l’occupation américaine du Japon: les données sur les victimes des bombes n’ont été partiellement rendues publiques qu’après 1955, face à une contestation internationale des essais atomiques.
Depuis 75 ans, les pratiques de rétention, de dissimulation et de déni des effets délétères du nucléaire se multiplient. Elles concernent les victimes des essais atomiques, les habitants des Iles Bikini et Marshall ou les vétérans, les travailleurs du nucléaire: ceux des «villages nucléaires» de Hanford aux États-Unis ou de Maiak en Union Soviétique, les mineurs africains, kazakh ou américains ou encore les «nomades du nucléaire», ces ouvriers temporaires du nucléaire en France, au Japon et ailleurs.
Ces pratiques s’accompagnent d’une disqualification du vécu et des paroles des victimes, ajoutant à la violence physique, la violence symbolique du déni des souffrances. Les habitants de la région de Tchernobyl l’ont éprouvée, et 34 ans après, les controverses sur les victimes et les effets de cet accident industriel majeur continuent.
Surveillance, réglementations, culture du secret, de la sûreté et de la sécurité, tel est le prix à payer pour vivre dans un monde nucléaire. Le physicien américain Alvin Weinberg estimait en 1972 que l’on trouverait toujours des solutions techniques aux trois problèmes majeurs que pose l’énergie nucléaire, à savoir la sécurité des réacteurs, le transport des matières radioactives et le traitement des déchets radioactifs. Mais il ajoutait que « ce pacte faustien » avec l’atome a un coût social : accepter de vivre sous la tutelle du «clergé militaire» mis en place pour le contrôle des armes nucléaires et dont dépend notre survie.
En faisant d’Hiroshima un lieu de mémoire, un sanctuaire du pacifisme mondial, on n’a pas changé le cours de l’histoire. La peur d’une apocalypse nucléaire n’a pas suffi à entamer l’optimisme technologique d’un futur radieux. En 2020 l’aiguille du jugement inventée en 1947 par les savants atomistes pour alerter sur le danger d’un anéantissement de l’humanité est repositionnée sur deux minutes avant minuit comme au temps de la Guerre froide. Mais le nucléaire est si bien implanté dans le décor qu’on oublie sa présence, même si elle retient pour un temps l’attention des médias quand survient un accident ou une catastrophe. Face aux effets anesthésiants de ce curieux mélange de mémoire et d’oubli, il importe de s’interroger ce que le nucléaire a fait à nos sociétés comme à notre rapport au monde.
Philosophe, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Historienne et sociologue des sciences et de l’environnement, Université de Paris
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.