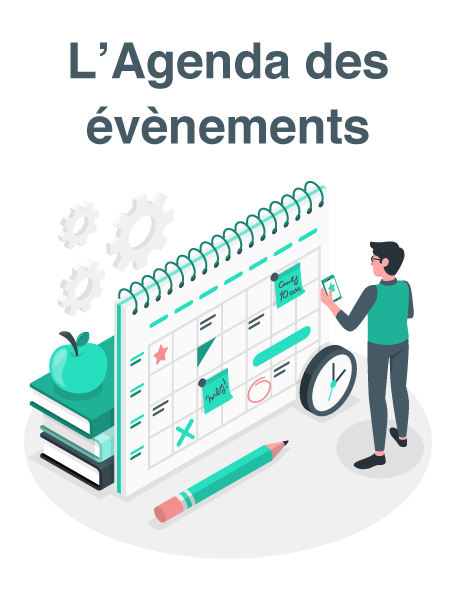Satisfaisant un besoin basique au sens de Maslow et intéressant l’ensemble de la société en sollicitant des disciplines aussi diverses que la géographie, la démographie, la sociologie, l’économie, le droit et la science politique, le logement est un fait social total au sens de Marcel Mauss. Le logement est en outre le principal bien des ménages et pèse en 2023 dans le monde 290.000 milliards de dollars soit plus que la somme des actions et des obligations cotées.
Crise du logement et crise de la construction
Les médias se focalisent souvent sur la saturation des 200.000 places d’hébergement d’urgence en hiver et les 300.000 personnes sans domicile fixe (soit le double de 2012) mais pour prendre conscience de l’ampleur du problème, il faut surtout relever que 2,7 millions de ménages (soit 100.000 de plus en un an) sont en attente d’un des 5,7 millions de logements sociaux en France et que le nombre de personnes mal-logées atteint 4,2 millions (sur 68,4 millions d’habitants).
Depuis 2021, cette crise du logement est exacerbée par une crise de la construction particulièrement violente. Ainsi, fin octobre 2024, les mises en chantier de logements sur 12 mois ont chuté de 33% par rapport à septembre 2023 à 259.000 unités, un niveau proche des points bas de 1992 et 1993, et 80.000 unités au-dessous de la moyenne historique. Et la chute de la production de logements sociaux (82.000 agréments en 2023, contre 124.000 de 2016) est tout aussi grave.
Un manque de 400 000 logements neufs par an
Longtemps, l’apanage des services de l’État et de la statistique publique, qui persiste d’ailleurs à sous-évaluer les besoins, l’évaluation du manque de logements a quitté le champ institutionnel pour celui de la recherche, gagnant au passage en sérieux et en qualité.
Notre synthèse de la riche littérature récente constate que ces études reposent sur des évolutions similaires des principaux paramètres clés d’ici 2030. Ainsi la hausse de la population principalement due à l’immigration nécessiterait entre 50.000 à 70.000 logements supplémentaires par an. Le desserrement des ménages en raison des comportements de décohabitation (divorces, vieillissement de la population, etc.) a d’ores et déjà entraîné une baisse constante de la taille des ménages passée de 2,6 personnes en 1990 à 2,2 en 2019. Elle devrait se poursuivre et représenter la première cause de la demande avec près de 150.000 logements par an.
La progression des résidences secondaires nécessiterait au moins 40.000 logements supplémentaires et la vacance (qui est multidimensionnelle entre la vacance structurelle à savoir la vétusté ou les locations peu attractives et la vacance rotationnelle, temporaire, comme la conjoncture du marché et les procédures liées aux successions) a minima 40.000. Enfin au renouvellement nécessaire du parc lié à la destruction et à la vétusté (plus de 30.000) s’ajoute la hausse des personnes mal logées soit 80.000. Globalement le besoin s’élèverait donc à environ 400.000 logements par an, même si les promoteurs avancent généralement des estimations plus élevées, entre 450.000 et 500.000.
Des causes bien connues
Outre la démographie, la concentration des emplois et la recherche de l’aménité des logements, un concept clé lié à la qualité de vie expliquent la hausse de la demande dans les métropoles. Comme l’offre est contrainte par la réglementation urbaine et la frilosité des élus locaux à accorder des permis de construire, le prix des logements dans les grandes villes qui était resté relativement stable en termes réels pendant près d’un siècle de 1870 à 1970 a fortement progressé depuis 1994 en France comme dans les autres pays riches, selon une étude américaine de 2017.
Quatre tendances plus récentes ont accentué ce phénomène. En premier lieu, l’apparition des plates-formes comme Airbnb a retiré des biens du marché résidentiel pour les consacrer à des locations de très courte durée, beaucoup plus rentables. Première destination touristique mondiale, la France est particulièrement touchée par cette tendance. Ensuite, la nécessaire lutte contre le dérèglement climatique a déclenché des mesures législatives et réglementaires interdisant à la location les passoires thermiques (4,8 millions de logements soit 16% du parc) ce qui réduit l’offre disponible.
Pour ne rien arranger, l’inflation depuis la guerre en Ukraine de février 2022 a renchéri significativement les coûts de construction qui ont augmenté en France de 17,4% de février 2020 à mai 2024. Enfin pour lutter contre cette flambée des prix, la BCE a relevé drastiquement ses taux directeurs passés de 0 à 4% en 18 mois, ce qui a entraîné les taux d’emprunts sur 20 ans de 1% au plus bas en 2021 à 4,2% au plus haut en 2023 (ils sont depuis revenus vers 3,33% pour les prêts à long terme à taux fixe en septembre 2024) soit une augmentation de 34% des mensualités de remboursement. Cela représente tout de même 312 euros par mois pour un crédit de 200.000 euros sur 20 ans « dé-solvabilisant » de nombreux primo-accédants.
Mais toutes ces raisons ne suffisent pas à expliquer l’ampleur de la crise du logement dans notre pays. Reste une cause trop souvent négligée et pourtant cruciale: la fiscalité de l’investissement immobilier dans le résidentiel.
Une fiscalité excessive sur l’immobilier résidentiel
Les biens immobiliers étant insusceptibles d’être déplacés dans une juridiction fiscale plus attrayante, leur imposition est ancienne et variée dans la plupart des pays. Or en 2024, la France détient toujours une triple couronne fiscale peu enviable : les prélèvements obligatoires les plus élevés de l’Union européenne à 45,6%, la fiscalité patrimoniale la plus forte et, au sein de celle-ci, la fiscalité immobilière la plus lourde. À titre d’exemple, les impôts récurrents sur la propriété immobilière représentent 2,2% du PIB en 2021 en France contre 1,1% dans l’OCDE et la part de la fiscalité du logement dans le total des prélèvements obligatoires est de 7,8% en France contre 4,8% en moyenne dans les autres pays.
Parmi les pays de l’OCDE la France se distingue également en cumulant les six grands types d’imposition patrimoniale aux différentes étapes du cycle économique: sur l’acquisition via les droits d’enregistrement (ou la TVA pour un logement neuf), sur la détention avec les impôts fonciers et l’impôt sur la fortune, sur les revenus du patrimoine, sur les mutations avec les droits de succession et de donation, et enfin sur les plus-values.
En outre, trois des impôts sur l’immobilier des ménages étant progressifs (le taux marginal d’imposition des revenus fonciers est de 62%, l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) de 1,5% et les droits de succession à 45% en ligne directe et même 60% sans lien direct), le rendement locatif après impôts est parfois négatif pour les gros patrimoines. D’autant que le plafonnement de 75 % de l’IFI prend en compte l’ensemble des revenus du contribuable et non pas seulement les revenus fonciers. Pour être exhaustif, il faudrait également ajouter le calcul (très complexe du fait de divers abattements) des plus-values de l’immobilier d’investissement mais en partie progressif et culminant à 42,20%.
Une imposition parfois confiscatoire: le cas de Paris
À l’exception de la résidence principale qui reste une oasis fiscale pour des raisons électorales évidentes (58% de propriétaires de leur résidence principale dans l’hexagone) avec une exonération explicite d’impôt sur le loyer que le propriétaire reçoit de lui-même et l’exonération des plus-values de cession, la fiscalité de l’investissement locatif est prohibitive. En conséquence, l’imposition peut s’avérer confiscatoire.
Ainsi à Paris le rendement brut d’un bien immobilier est d’environ 3% comme le rendement des obligations d’État à 10 ans, bien moins imposées, et peut donc s’avérer négatif dans certains cas, du fait de la somme des impôts et sans même prendre en compte la baisse moyenne des prix dans la capitale de 12,6% au 31 août 2024 depuis le point haut de novembre 2022 et de 8% en 5 ans.
Face au mur de la dette publique française, la situation va en outre s’aggraver à court terme car quel que soit le sort du projet de loi de finances pour 2025 le Pinel s’éteindra au 31 décembre 2024 ce qui mettra fin à 40 ans de dispositifs fiscaux destinés à favoriser l’investissement des particuliers dans l’immobilier neuf à usage locatif depuis le Quilès en 1984. Cet avantage fiscal sous forme de réduction d’impôt sur le revenu qui incitait les particuliers à investir dans des logements neufs destinés à la location intermédiaire pour environ 30.000 à 40.000 logements par an coûtait à l’État d’environ 1,1 milliard par an.
L’inévitable hausse des prix qui vient
Enfin, pour répondre à la demande des départements qui ont vu leurs recettes diminuer du fait de la chute des transactions dans les logements passées de 1.000.000 par an au plus haut en 2019 vers 750.000 en 2024 le gouvernement a proposé dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025 toujours en suspens de relever « les frais de notaire » départementaux de 4,5% à 5% soit une hausse de 10%. Cette mesure constituerait un frein supplémentaire à la mobilité et pèserait sur les primo-accédants alors même que les taxes sur les transactions immobilières représentent déjà en France 0,7% du PIB contre 0,47% en moyenne dans les pays OCDE.
Le recul de l’investissement des particuliers, la répugnance toujours très forte des investisseurs institutionnels à investir dans un secteur peu rentable et à fortes contraintes réglementaires ainsi que l’absence de moyens des bailleurs sociaux vont nécessairement raréfier l’offre, ce qui stoppera assez rapidement la présente baisse des prix. Dans les métropoles attractives, le déficit des logements va donc s’aggraver entraînant une hausse inévitable des prix et une ségrégation sociale et spatiale qui évincera les classes moyennes du secteur privé.
Éric Pichet Professeur et directeur du Mastère Spécialisé Patrimoine et Immobilier, Kedge Business School
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.