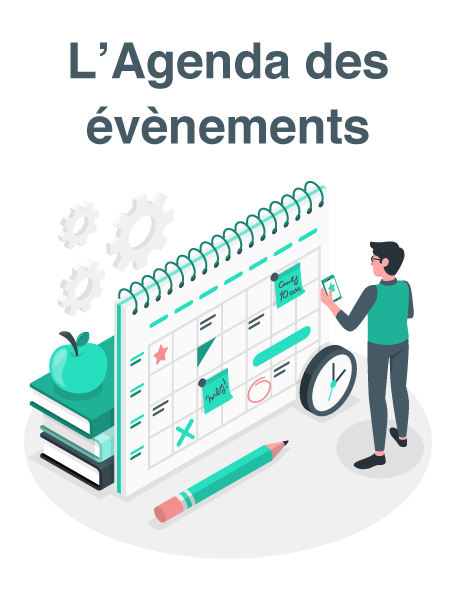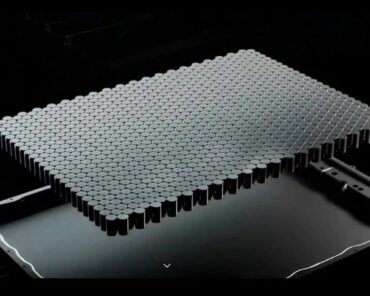En France, la seconde moitié du XXe siècle marque une accélération: c’est durant cette période que la population urbaine progresse le plus fortement pour devenir bien plus importante que la population rurale. À l’équilibre jusqu’à l’après-guerre, la part des urbains explose durant les «trente glorieuses» (1945-1973).
Dans les analyses de l’occupation humaine du territoire national, l’exode rural –ce phénomène qui désigne l’abandon des campagnes au profit des centres urbains– a marqué l’histoire de France et de ses territoires. En témoigne nombre de récits et d’études, à l’image des travaux de Pierre Merlin dans les années 1970 et, plus proches de nous, ceux de Bertrand Hervieu.
Ce long déclin des campagnes est documenté, pointé, par moment combattu. Mais depuis 1975, et surtout après 1990, des phénomènes migratoires nouveaux marquent un renversement. Le rural redevient accueillant. La périurbanisation, puis la rurbanisation ont enclenché le processus.
La période actuelle marquée par un contexte sanitaire inédit questionne encore plus largement. N’assisterait-on pas à un renversement spatial?La crise en cours semble en tous cas accélérer le phénomène et faire émerger une «transition rurale». Si cette hypothèse peut être débattue au niveau démographique, politique, économique et culturel, elle nous pousse surtout à faire émerger un nouveau référentiel d’analyse, non plus pensé depuis l’urbanité, mais depuis la ruralité.
De l’exode rural…
Dans la mythologie moderne française, l’exode rural a une place reconnue. Les campagnes, qui accueillent jusque dans les années 1930 une majorité de Français, apparaissent comme le réservoir de main-d’œuvre dont l’industrie, majoritairement présente dans les villes a alors cruellement besoin. Il faut ainsi se rappeler qu’à cette époque, la pluriactivité est répandue et que les manufactures ne font pas toujours le plein à l’heure de l’embauche en période de travaux dans les champs.
Il faudra attendre l’après-Seconde Guerre mondiale, alors que le mouvement se généralise, pour que la sociologie rurale s’en empare et prenne la mesure sociale des conséquences, jusqu’à proclamer, en 1967 avec Henri Mendras, «la fin des paysans».
L’urbanisation constitue le pendant de ce phénomène et structure depuis la géographie nationale. Dans ce contexte, la concentration des populations à l’œuvre avait déjà alerté, comme en témoigne le retentissement de l’ouvrage de Jean‑François Gravier Paris et le désert français (1947). Quelques années plus tard, une politique d’aménagement du territoire redistributive sera impulsée ; elle propose une délocalisation volontaire des emplois de l’Ile-de-France vers la « province », mais sans véritablement peser sur l’avenir des campagnes. Le temps était alors surtout aux métropoles d’équilibre et aux grands aménagements (ville nouvelle – TGV – création portuaire).
Pour la France des campagnes, l’exode rural se traduisit par un déplacement massif de population, mais aussi, et surtout, par une perte d’identité culturelle et une remise en cause de ses fondements et de ses valeurs.
Le virage de la modernité, avec sa recherche de rationalité, de productivité et d’efficacité, ne fut pas négocié de la même manière. Les campagnes reculées, où se pratique une agriculture peu mécanisable, subirent de plein fouet le « progrès » ; tandis que d’autres milieux agricoles du centre et de l’ouest de la France s’en tirèrent mieux. L’exploitant agricole remplace désormais le paysan ; des industries de transformation, notamment agroalimentaires, émergent. Mais globalement, le rural quitta sa dominante agricole et avec elle ses spécificités. La campagne, c’était la ville en moins bien.
Ce référentiel, subi par les populations « restantes », structurait la vision nationale et avec elle les logiques d’action de l’État. Cette histoire se poursuivit, comme en témoignent les politiques actuelles de soutien à la métropolisation, heureusement questionnées par quelques-uns.
à l’exode urbain!
Le recensement de 1975 marque un basculement. Pour la première fois, la population rurale se stabilise et des migrations de la ville vers ses périphéries sont à l’œuvre.
Le mouvement qualifié de «périurbanisation» puis de «rurbanisation» marquait une continuité, toujours relative et fixée par rapport à la ville. La «périurbanisation» exprimait les migrations en périphéries, un desserrement urbain. La «rurbanisation», la généralisation du mode de vie urbain, même loin d’elle. Le processus n’est pas homogène et il explique pour une grande part la fragmentation contemporaine de l’espace rural en y conférant des fonctions résidentielles ou récréatives, sur fond d’emplois agricoles devenus minoritaires. Ainsi, la banlieue lyonnaise, l’arrière-pays vauclusien et la campagne picarde offrent différents visages de la ruralité contemporaine.
Parallèlement, dans les territoires les plus délaissés (en Ardèche, dans l’Ariège, dans les Alpes-de-Haute-Provence par exemple), un «retour à la terre» s’opère. Si le grand public connaît ces nouveaux résidents sous l’appellation de «néo-ruraux», des moments successifs peuvent être distingués.
La chercheuse Catherine Rouvière s’intéressa à ce phénomène en Ardèche ; elle le décrypte en 5 moments.
Les premiers, avec les «hippies» (1969-1973), marquèrent culturellement le mouvement, mais peu l’espace, à l’inverse des «néo-ruraux proprement dits» (1975-1985) qui réussirent plus largement leur installation. Plus tard, les «travailleurs à la campagne» (1985-1995) furent les premiers à faire le choix d’exercer leur métier ailleurs qu’en ville. Enfin, les politiques néolibérales engagèrent dans ce mouvement les «personnes fragiles fuyant la ville» (1995-2005) et mirent en action les «altermondialistes» (2005-2010). Le départ de la ville est donc ancien.
Jean‑Paul Guérin, voit déjà en 1983 dans ce phénomène d’exode urbain une opportunité pour les territoires déshérités de retrouver une élite. Ce qu’on qualifie aujourd’hui d’émigration massive avait ainsi été repéré depuis près de 30 ans, même si l’Insee l’a toujours méthodiquement minoré.
Vers une transition rurale?
Présenter ainsi l’histoire contemporaine des migrations françaises de manière symétrique et binaire est pourtant trompeur.
Tout comme l’exode rural est à nuancer, l’exode urbain engagé il y a des décennies mérite de l’être aussi. Les relations ville-campagne sont bien connues, la ruralité se décline dorénavant au pluriel et de nouveaux équilibres sont souvent recherchés. Malgré cela, la période actuelle nous oblige à poser un regard différent sur cette histoire géographique au long cours. La crise de la Covid-19 marque une accélération des mouvements.
Aujourd’hui, quelques auteurs s’interrogent et proposent des ajustements. En appelant à une Plouc Pride, une marche des fiertés des campagnes, Valérie Jousseaume nous invite ainsi collectivement à nous questionner sur la nouvelle place de la ruralité.
Et si, au fond, cette tendance témoignait d’un basculement, d’une transition, d’un tournant rural, démographique, mais aussi et surtout culturel?
La période rend en effet visible «des exilés de l’urbain» qui s’inscrivent clairement dans un autre référentiel de valeurs, dans la continuité de ce qui fut appelé les migrations d’agrément. Celles-ci, repérées initialement en Amérique du Nord dans les années 1980 puis en France dans les années 2000, fonctionnent sur une logique de rapprochement des individus à leurs lieux de loisirs et non plus de travail.
L’enjeu pour ces personnes consiste à renoncer à la ville et non plus de continuer à en dépendre. Dans la ruralité, de nombreux territoires conscients de ce changement tentent de s’affirmer, comme la Bretagne ou le Pays basque.
Pourtant ils versent souvent, à l’image des métropoles, dans les politiques classiques de compétitivité et d’attractivité (marketing territorial, politique culturelle, territoire écologique, créatif, innovant visant à attirer entrepreneurs urbains et classes supérieures) et peu s’autorisent des politiques non conventionnelles. Ce phénomène mimétique nous semble d’autant plus risqué que dès 1978, Michel Marié et Jean Viard nous alertaient en affirmant que «les villes n’ont pas les concepts qu’il faut pour penser le monde rural». Mais alors, comment penser depuis la ruralité?
Il s’agit d’ouvrir un autre référentiel qui pourrait à son tour servir à relire les dynamiques contemporaines. Le référentiel urbain moderne a construit un monde essentiellement social, prédictif et rangé. Ses formes spatiales correspondent à des zonages, des voies de circulation rapides et de l’empilement. Ici, l’artificialité se conjugue avec la densité.
Le rural accueille, en coprésence, une diversité de réalités. Ainsi, la naturalité se vit dans la proximité. Ce phénomène n’est pas exclusif aux territoires peu denses, la naturalisation des villes est d’ailleurs largement engagée. Mais l’enjeu de l’intégration de nouveaux habitants dans le rural est d’autant plus fort, qu’en plus de toucher la vie des communautés locales, il se doit de concerner ici plus encore qu’ailleurs les milieux écologiques.
Le trait n’est plus alors celui qui sépare (la frontière), mais devient celui qui fait lien (la connexion). La carte, objet du géographe, doit aussi s’adapter à ce nouvel horizon. Et la période qui s’ouvre accélère tous ces questionnements !
L’histoire de la civilisation humaine est née dans les campagnes, premiers lieux défrichés pour faire exister le monde. La ville n’est venue que plus tard. Son efficacité a par contre repoussé la limite jusqu’à dissoudre la campagne prise entre urbanité diffuse et espace naturel. Mais face aux changements en cours, à un nouvel âge de la dispersion, la question qui se pose apparaît de plus en plus: pour quoi a-t-on encore besoin des villes?
Nicolas Senil Géographe, ingénieur de recherches, Université Grenoble Alpes (UGA)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons Lire l’article original sur The Conversation.