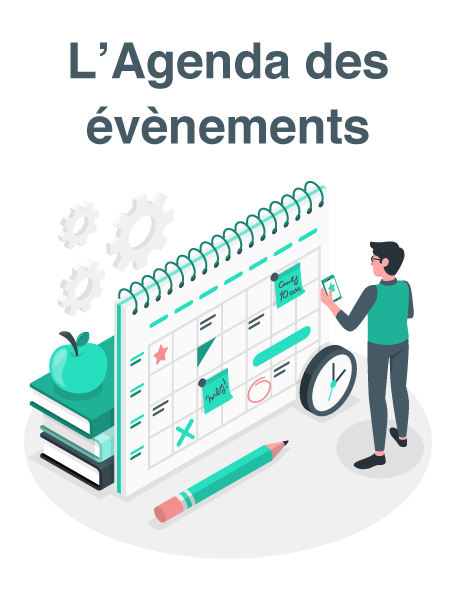La notion de «précarité énergétique» fête ses dix ans. Ce à quoi elle renvoie est bien sûr plus ancien, mais l’expression a été popularisée en France par son inscription dans la loi en 2010. L’actualité des deux dernières années a rappelé l’importance qu’elle occupe dans l’espace public, avec la fin du tarif de première nécessité pour l’électricité (TPN) et du tarif spécial de solidarité pour le gaz (TSS), deux mécanismes qui ont été remplacés par le chèque-énergie en 2018.
À la suite du mouvement des gilets jaunes à l’automne, le gouvernement décide d’élargir le dispositif. En février 2020, le hashtag #LesMalChauffés est lancé par franceinfo dans le cadre d’une opération. Et à la même période, la trêve hivernale est prolongée par ordonnance dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19.
Pourtant, qualifier et quantifier ce phénomène n’est pas aussi évident qu’il n’y paraît. Traduite de l’anglais «fuel poverty», la précarité énergétique est définie officiellement en France dans la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 de la façon suivante: «Est en situation de précarité énergétique […] une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat.»
Cette définition fait ainsi se croiser question sociale et question écologique, mais ne précise pas ce que recouvrent les «besoins élémentaires». Cependant, les actions privées ou publiques autour de la prise en charge du phénomène (que ce soit sur le plan de la pauvreté, des difficultés de paiement ou encore de la rénovation du bâti) sont antérieures à cette inscription dans la loi. Mais celle-ci ouvre une période de à la fois des questionnements sur les outils disponibles pour qualifier et quantifier ce phénomène et des questionnements sur la possibilité d’y répondre dans le cadre d’une politique de transition énergétique.
Une définition imprécise et un problème difficile à quantifier
En 2011 est créé l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) auquel il est confié une triple mission: observer la précarité énergétique et analyser les politiques publiques associées, contribuer à l’animation du débat sur la précarité énergétique, valoriser et diffuser les travaux sur le phénomène. Il se compose d’organisations publiques et privées, et fait ainsi se rencontrer des acteurs étatiques de différents domaines, des acteurs du marché de l’énergie et du logement, des organisations du monde de l’ESS…
Il publie deux fois par an un tableau de bord de la précarité énergétique afin de mettre à jour les données disponibles sur le phénomène et les indicateurs… et c’est précisément là que les choses se complexifient. Mesurer la précarité énergétique, oui, mais avec quelles données et à partir de quels indicateurs? C’est une des premières questions auxquelles l’ONPE a dû répondre… et la question reste d’actualité. Jérôme Vignon, président de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, le signalait dès la publication du premier rapport de l’ONPE en 2014:
«Rien ne semble a priori plus simple que de mesurer la « précarité énergétique ». Ne dispose-t-on pas d’ailleurs d’un indicateur robuste, le taux d’effort énergétique ? […] Pourtant, si l’on prend vraiment au sérieux les multiples situations réelles de précarité énergétique, une telle approximation est insuffisante, voire contreproductive. Elle fera regarder comme précaires des habitants qui ne se soucient pas vraiment de leur facture et négligera d’autres dont l’effort n’est réduit qu’au prix d’une auto restriction qui menace leur bien-être.»
20% de précaires énergétiques, une constante
La précarité énergétique se mesure actuellement en combinant trois indicateurs:
- Le taux d’effort énergétique: il calcule le niveau des dépenses en énergie pour le logement sur l’ensemble des dépenses d’un ménage et positionne le résultat par rapport à un seuil de 8%.
- L’indicateur bas revenu dépense élevé, décliné par unité de consommation ou par mètre carré: il rapporte les dépenses en énergie au revenu d’un ménage.
- L’indicateur de froid: il étudie le froid ressenti par un ménage à partir de différents critères.
Ces indicateurs sont étudiés sur les trois premiers déciles de niveau de vie de la population.
Les données utilisées proviennent des Enquêtes nationales logement (ENL) dont la dernière édition date de 2013 (une ENL 2020 est en cours), de résultats d’actualisation de ces ENL à partir de modèles statistiques, et ponctuellement d’autres enquêtes de la statistique publique. Étant donné le caractère multidimensionnel de la précarité énergétique, d’autres données sont également retenues: des fichiers administratifs, des fichiers clients, des données de terrain…
En combinant les trois indicateurs avec l’ENL de 2013, l’ONPE établissait ce nombre de ménages à 5,1 millions, c’est-à-dire 12 millions de Français, soit une personne sur cinq.
Au regard du Tableau de bord de la précarité énergétique publié par l’ONPE pour le 1er semestre 2020, on constate une stabilité du nombre de ménages en précarité énergétique, stabilité existante depuis plusieurs années: 11,7% pour le seul taux d’effort énergétique, c’est-à-dire 3,4 millions de ménages (soit 6,7 millions de personnes).
Des données contradictoires
Cette stabilité masque des données contrastées. Ainsi, le montant annuel des dépenses énergétiques par ménage, pour le logement et pour le carburant, est passé de 2491€ en 2009 à 3121€ en 2018 alors que, dans le même temps, la consommation énergétique du parc résidentiel entre ces deux années est passée de 203,9 kWh par m2 à 171,3 kWh par m2.
Face à ces données, celles issues «du guichet» invitent à questionner le contexte institutionnel dans lequel la prise en charge est menée. D’un côté, le nombre d’interventions des fournisseurs pour impayés est passé de 623.599 en 2014 à 671.546 en 2019 mais d’un autre côté le nombre de dossiers «Habiter mieux» déposés à l’Anah pour bénéficier d’une aide à la rénovation est passé de 62.510 en 2018 à 117.093 en 2019…
Mais de qui parle-t-on finalement? Dans les indicateurs utilisés, la personne dite «précaire énergétique» est d’abord un «ménage», que celui-ci soit qualifié de «(très) modeste» ou de «pauvre» au regard de ses conditions de ressources, ou non.
Dans les organisations impliquées dans la prise en charge de la «lutte contre la précarité énergétique», la personne en situation de précarité énergétique est d’abord un client, un bénéficiaire, un usager, un administré, un citoyen, un habitant (parfois propriétaire, parfois locataire, voire même bailleur). À ce niveau, «la» précarité énergétique est peut-être plus une catégorie d’action publique qu’une caractéristique identifiant une personne ou à laquelle une personne peut s’identifier. Cela contribue ainsi à créer un décalage entre ce que reflètent les indicateurs et ce que prennent en charge les organisations « sur le terrain ».
Une prise en charge qui interroge
De là à en conclure que nous ne sommes pas plus avancés aujourd’hui qu’il y a dix ans, certainement pas. La connaissance de la précarité énergétique s’est développée et la législation l’intègre aux côtés de problématiques sociales et écologiques.
Toutefois, elle interroge toujours la pertinence de l’action collective, publique ou privée, mise en place pour la prendre en charge. Le chèque-énergie, par exemple, est attribué non pas en fonction du niveau de dépenses en énergie d’un ménage, d’une situation d’impayés d’énergie ou des caractéristiques de son logement mais à partir du nombre de parts et du revenu fiscal.
La dernière décennie a surtout été le théâtre de multiples formes de coordination entre des acteurs aux statuts et missions variés. S’articulent ainsi des actions de SA, SARL, associations, mutuelles, fondations, coopératives, autorités publiques indépendantes, établissements publics… Plus que sa réalité, c’est peut-être l’apparition de nouveaux acteurs et la multiplication de textes, normes et dispositifs qui font le succès de la notion de précarité énergétique et contribuent à créer ses paradoxes.
Adèle Sébert Doctorante en sciences économiques, Université de Lille
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons Lire l’article original sur The Conversation.