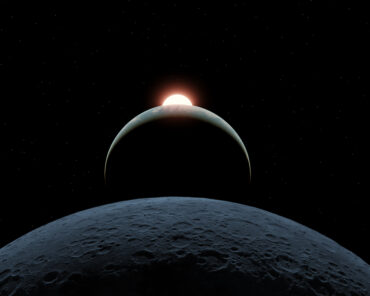L’importance de l’énergie comme carburant des économies et des civilisations est trop souvent mal comprise, ignorée voire minorée. Voilà notamment pourquoi les décisions politiques en matière énergétique qui ont un impact aussi important et durable et leurs conséquences sont aussi mal mesurées et mal anticipées. Il suffit simplement de se pencher sur le rapport de Mario Draghi, rendu public en septembre dernier. Il démontre que l’appauvrissement relatif de l’Europe depuis deux décennies est avant tout la conséquence d’une envolée des prix de l’énergie… Elle est devenue aujourd’hui deux à trois fois plus chère en Europe (gaz naturel et électricité) pour les entreprises qu’aux États-Unis et en Chine.
Les comparaisons sont faciles, car l’énergie est la seule monnaie vraiment universelle. Elle est indispensable pour accomplir quoi que ce soit. Le plus incroyable est que décideurs politiques et économiques et experts de tous ordres oublient souvent cette évidence.
La recherche d’accès à des formes d’énergie plus abondantes et plus concentrées
L’activité économique peut se résumer à 99 % à des transferts d’énergie. Les civilisations se sont construites et développées en accédant à des sources et des formes d’énergie plus abondantes et plus faciles, qu’il s’agisse de l’énergie animale, hydraulique, éolienne, fossile, solaire, nucléaire…
« D’un point de vue biophysique fondamental, l’évolution humaine préhistorique et le cours de l’histoire peuvent être considérés comme la recherche de la maîtrise de réserves et de flux plus importants de formes d’énergie plus concentrées et plus polyvalentes et de leur conversion, de manière plus abordable, à moindre coût et avec une efficacité accrue, en chaleur, en lumière et en mouvement », écrit Vaclav Smil dans l’introduction de son livre Energy and Civilization : A History (Énergie et civilisation : Une histoire).
L’extraction du sous-sol de prodigieuses réserves de combustibles fossiles
Les sociétés préindustrielles utilisaient avant tout l’énergie musculaire humaine et animale et une toute petite fraction de l’énergie éolienne, hydraulique et solaire (par le biais de la photosynthèse). Les civilisations modernes se sont construites et développées depuis deux siècles et demi seulement par l’extraction du sous-sol de prodigieuses réserves de combustibles fossiles et en épuisant des gisements de charbon, de pétrole et de gaz qui ne pourront pas être reconstitués même à une échelle de temps bien supérieure à celle de l’existence de notre espèce.
On ne mesure plus l’ampleur de la transformation énergétique qu’a connu l’humanité tant cela nous semble être acquis et aller de soi. Rien ne la résume mieux que cet exemple. En 1900, un riche agriculteur de la Beauce qui tenait les rênes de six chevaux de trait pour labourer ses champs de blé avait alors sous la main le contrôle de 5 kW d’énergie animale. Un siècle plus tard, son arrière-petit-fils, assis au-dessus du sol dans le confort climatisé de la cabine de son tracteur, contrôlait sans effort plus de 250 kW provenant d’un moteur diesel.
Des répercussions majeures dans toutes les dimensions des sociétés
On peut aussi mesurer la révolution énergétique par l’accélération de la production des combustibles fossiles. Celle de charbon est passée de 1 million de t à 1 GT (gigatonne), multipliée par 100, entre 1810 et 1910. Elle a atteint l’an dernier le niveau record de 8,77 Gt. De la même façon, la production de pétrole, qui était de moins de 10 millions de t à la fin des années 1880, a atteint 3 Gt un siècle plus tard (300 fois plus) et était l’an dernier de 5,9 Gt. Enfin, la production de gaz naturel, moins de 2 Gm3 (gigamètres cubes) à la fin des années 1880, était 1 000 fois plus grande à 2 Tm3 (téramètres cubes) en 1991 et de 10 Tm3 l’an dernier.
La transition historique vers les combustibles fossiles a eu des répercussions majeures dans toutes les dimensions des sociétés : l’agriculture, l’industrie, les transports, les armes, les guerres, la communication, la culture, l’économie, l’urbanisation, la qualité de vie, la politique et… l’environnement. La consommation toujours plus importante d’énergies fossiles par une humanité toujours plus nombreuse et prospère, qui a battu l’an dernier les records de consommation de charbon, de pétrole et de gaz, a un impact négatif grandissant sur la biosphère. Elle s’est traduite notamment par une augmentation cumulative de la concentration de certains gaz à effet de serre (avant tout carbone et méthane) dans l’atmosphère et une augmentation corrélative des températures.
Les enseignements de l’histoire
Les dirigeants des grands pays du monde, sous la pression des organisations internationales et de nombreux mouvements militants aux motivations très diverses allant de l’écologie politique à la destruction du capitalisme, se sont engagés depuis plus de trente ans, plus ou moins sérieusement, dans une transition énergétique visant à substituer aux combustibles fossiles des énergies qui émettent beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mais les uns et les autres sont loin d’avoir mesuré l’échelle des transformations à mener et ce que cela signifie pour l’humanité. L’histoire est pourtant pleine d’enseignements.
Elle montre que l’énergie est l’un des principaux moteurs de l’essor et du déclin des civilisations. Depuis les sociétés agraires alimentées par les muscles humains et animaux jusqu’à la dépendance de la révolution industrielle au charbon et la transition ultérieure vers le pétrole et le gaz à l’ère moderne, la relation symbiotique entre énergie et progrès social est évidente.
Nous comprenons très mal ce que nous faisons
À chaque transition, la disponibilité de l’énergie a été à la fois un catalyseur de progrès et de transformations environnementales. Qu’il s’agisse de la déforestation provoquée par le besoin insatiable de bois ou le défi contemporain créé par les émissions de carbone et le changement climatique.
Nous comprenons très mal ce que nous faisons. Nous sommes incapables de maîtriser des systèmes très complexes et interdépendants, à savoir les interactions entre les processus biosphériques, la production d’énergie, l’activité économique, les progrès technologiques, les changements sociaux et politiques, les conflits… Cela explique pourquoi les scénarios de transition énergétique et leur impact climatique sont de pures spéculations. Ce qui ne les empêche pas de se multiplier et d’être mis en avant à tort et à travers, surtout s’ils sont apocalyptiques.
La décroissance est un leurre
Ce que nous pouvons anticiper aujourd’hui, sans grand risque de nous tromper, est qu’il faudra encore plus d’énergie aux générations à venir pour permettre à une part plus grande de l’humanité d’accéder à une qualité de vie décente. Ce qui ne sera pas évident à accomplir. Ce n’est pas pour rien si les deux pays de loin les plus peuplés de la planète, l’Inde et la Chine, consomment année après année toute l’énergie à laquelle ils peuvent accéder sous toutes ses formes, du charbon au solaire en passant par l’hydraulique, le gaz et le nucléaire…
Voilà pourquoi notamment la décroissance est un leurre. Dans les pays riches, un nombre non négligeable de personnes, pas toujours mal intentionnées, trouvent quelque chose de séduisant dans la rhétorique de la décroissance : anti-consumérisme, vie plus simple, anti-capitalisme, rejet du progrès technologique, production et alimentation locales… Une espèce de nostalgie d’un monde compréhensible, maîtrisable, à portée de main, qui a du succès dans la chambre d’écho académique et médiatique depuis 1972 et le fameux rapport du Club de Rome. Sauf que cette solution n’en est pas une pour assurer la survie de 8 milliards d’êtres humains. Leurs besoin matériels minimum de nourriture, de santé, d’éducation, de logement, de transports, de moyens de production, d’énergie pour se chauffer, s’éclairer… ne peuvent pas être satisfaits par le retour à un passé fantasmé.
Les ruptures technologiques, à la fois indispensables et illusoires
La décroissance est un danger politique. Car elle ne peut être imposée aux populations que par la coercition. Parce que dès que l’on entre dans le détail, une économie en régression constante signifie obligatoirement la fin de la plupart des facilités offertes par la vie moderne. On passe immédiatement de l’utopie à la dystopie.
En matière d’utopie, les ruptures technologiques pourraient permettre de sortir de l’impasse actuelle. Sauf que par définition, elles sont très difficiles à anticiper, indispensables et illusoires (lire page 25). Il y en a deux qui ont très certainement le potentiel de changer la donne. Avoir la capacité de construire bien plus rapidement et en série des réacteurs nucléaires de la génération actuelle et plus encore de la génération suivante, la quatrième (neutrons rapides et surgénération), et parvenir à stocker à grande échelle et à des coûts acceptables l’électricité renouvelable éolienne et solaire.
Ce que nous enseigne l’histoire est qu’il ne faut jamais sous-estimer l’ingéniosité humaine. Les progrès majeurs dans la capacité à utiliser l’énergie ont toujours été la conséquence de ruptures technologiques. C’est pourquoi, sans être techno béat et croire à des solutions miracles, il faut consacrer des moyens importants, humains et financiers, au développement de nouvelles technologies énergétiques qui seules peuvent donner accès à l’humanité à une énergie abondante, abordable et compatible avec la nécessité de préserver la biosphère. De toute façon, nous n’avons pas vraiment le choix. La décroissance est une illusion, les peuples n’en veulent pas, et nous devons absolument nous débarrasser des fossiles avec lesquels nous avons construit pierre par pierre notre modernité.