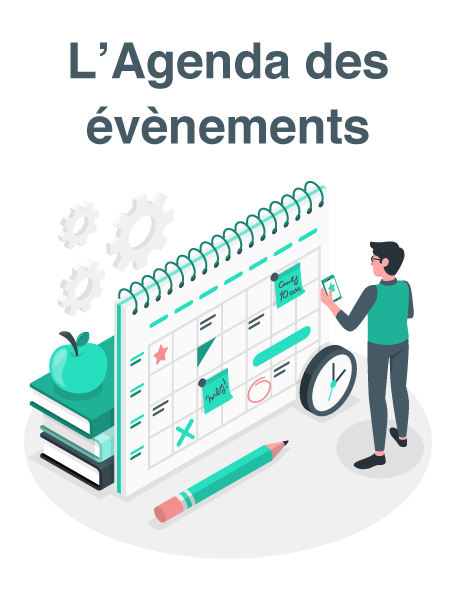Après l’Ukraine et la Palestine, le nucléaire fait partie des thèmes qui auraient pu empêcher l’union de la gauche. Et si un nouveau Front populaire a finalement pu émerger, cette gauche unie pour les prochaines élections législatives s’est bien gardée de se prononcer dans son programme sur les constructions prévues de nouvelles centrales nucléaires lancé en raison des conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine.
Ce jeudi 20 juin au matin, le député sortant LFI Éric Coquerel a finalement concédé, devant les grands patrons français, que le Nouveau Front populaire, s’il arrivait au pouvoir, ne toucherait pas au parc nucléaire français et ne remettrait pas en cause les politiques engagées. C’est un compromis certain pour celui dont le parti milite pour la sortie du nucléaire, mais aussi une prise de position révélatrice de l’état divisé de la gauche sur le sujet avec des écologistes et insoumis hostiles au nucléaire civil, des communistes très attachés à celui-ci et des socialistes plutôt favorables.
Pourtant, derrière les apparences, historiquement, la gauche française n’est pas fondamentalement hostile au nucléaire sous toutes ses formes, hormis ses franges issues de la deuxième gauche autogestionnaire et antiautoritaire née de l’agitation post-1968.
La gauche a même joué un rôle essentiel dans le développement des programmes nucléaires français, allant même, en ce qui concerne le militaire, jusqu’à faire couler le Rainbow Warrior un bateau de Greenpeace qui voulait empêcher des essais nucléaires en Polynésie française en 1985, lorsqu’elle était au pouvoir.
Remontons donc un peu en arrière pour tâcher de comprendre comment l’on est passé d’une gauche soutien historique du nucléaire aux divisions actuelles.
Un soutien historique et incontestable au nucléaire
L’incarnation à gauche du nucléaire est sans contexte Frédéric Joliot, gendre de Marie et Pierre Curie, physicien lauréat avec sa femme Irène Curie, du prix Nobel de Chimie de 1935 et engagé par ailleurs dans les rangs du Parti communiste.
Avec son équipe du Collège de France, il dépose en 1939 trois brevets : la réalisation d’un réacteur, les moyens de le stabiliser et enfin un explosif révolutionnaire prélude à la bombe atomique.
Après-guerre, il défend auprès du président du gouvernement provisoire, Charles de Gaulle, la relance des recherches nucléaires françaises ce qui aboutit à la signature de l’ordonnance du 18 octobre 1945 créant le commissariat à l’énergie atomique (CEA) dont il devient le premier haut-commissaire.
S’ouvre alors un premier apparent « consensus » nucléaire en France puisque toutes les forces politiques s’entendent pour soutenir des recherches purement civiles. Les communistes par patriotisme et par espoir d’une énergie émancipatrice pour les travailleurs sont enthousiastes face aux espoirs que suscite l’atome et expriment ainsi leur confiance dans le progrès scientifique.
Toutefois, le déclenchement de la guerre froide à partir de 1947 et surtout l’engagement de Joliot dans le mouvement de la paix sous influence soviétique, notamment l’appel de Stockholm demandant en 1950 l’interdiction de l’arme nucléaire, aboutissent à son renvoi et à celui des autres chercheurs communistes du CEA.
La fin de ce « consensus » ne porte que sur le programme militaire, soutenu à bas bruit dans les années 1950 par la gauche non communiste, en particulier Pierre Mendès France et Guy Mollet, chefs de gouvernement qui prennent des décisions décisives dans la marche de la France vers la bombe.
Tout le monde continue par ailleurs d’appuyer sans aucune ambiguïté les recherches civiles. Le plan quinquennal atomique de 1952 est ainsi approuvé alors qu’il finance les premiers réacteurs du CEA, producteurs d’électricité mais dont le plutonium sert à concevoir les premiers explosifs nucléaires français. Le retour au pouvoir de Gaulle en 1958 fait ensuite basculer la gauche dans l’opposition au programme militaire jusqu’en 1977-1978 pour les communistes et les socialistes tandis que le soutien aux applications civiles demeure.
L’émergence de l’opposition antinucléaire et son échec
Mais alors que les grandes forces de gauche se rassemblent autour d’un programme commun en 1972 et réalisent un premier pas en faveur de la bombe en acceptant les armes tactiques (du champ de bataille) et en conservant les stocks existants, émerge une opposition antinucléaire.
Hors des grands partis, elle conteste l’ensemble du nucléaire mais finit par privilégier la question énergétique. L’historienne et sociologue Sezin Topçu a décrit les premières organisations du début des années 1970 critiques de la « gouvernementalité » que représente le nucléaire et dénonçant un modèle technicien et autoritaire faisant fi des risques au nom de l’industrialisation. Il s’agit notamment d’élites intellectuelles qui s’engagent dans des associations comme la branche française du mouvement américain les Amis de la Terre. Les structures sont également locales avec l’expansion des projets nucléaires à Fessenheim en Alsace, dans la Hague en Basse-Normandie et dans le Bugey.
À partir de 1974, le mouvement gagne en puissance avec d’importantes organisations comme la CFDT contre le « plan Messmer » d’équipement massif en centrales nucléaires sous licence américaine pour répondre à la crise énergétique survenue en 1973. Les mobilisations sont particulièrement fortes contre le projet de surgénérateur Superphénix en Isère en 1976-1977, au Pellerin en Loire-Atlantique et à Plogoff dans le Finistère en 1980. Autour de cette commune, le mouvement est massif rassemblant la quasi-totalité des élus de gauche, socialistes compris, avec un sentiment de trop-plein après la construction de la base de sous-marins nucléaires à l’Île-Longue et le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz.
Le parti communiste, lui, reste pleinement favorable au nucléaire. Ce divorce idéologique à gauche, déjà observé lors de la contestation de mai 1968, se comprend dans la fidélité du PCF à ses convictions et son électorat dont beaucoup sont ouvriers de l’industrie, d’État en particulier, syndiqués à la CGT. Ils sont très présents dans EDF-GDF née de la nationalisation de la production énergétique en 1945 sous l’impulsion du communiste, ministre de la production industrielle Marcel Paul. C’est avec le soutien des commissions d’action sociale de l’entreprise qu’est d’ailleurs ouvert un espace d’information Marcel Paul et est inaugurée une stèle hommage en 2012 sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville… tout un symbole !
De son côté, le mouvement antinucléaire à caractère écologiste et d’extrême gauche connaît ses premières difficultés avec la violence des manifestations contre Superphénix en 1977. Il connaît un léger regain avec l’accident américain de Three Mile Island en 1979. L’élection présidentielle de 1981 voit des candidats antinucléaires mais qui ne réalisent que de faibles scores de 1 à 2 % : Michel Crépeau pour le mouvement des radicaux de gauche (centre gauche) et Huguette Bouchardeau pour le très à gauche parti socialiste unifié (PSU), elle seule se prononce aussi contre les armes nucléaires. Surtout, l’élection de François Mitterrand pour lequel, « le clivage [avec les écologistes] commence avec le nucléaire » enterre cette contestation.
Essentiellement de gauche, les quelques forces françaises antinucléaires se retrouvent de fait désarmées avec l’arrivée de celle-ci au pouvoir, privilégiant la réussite de l’expérience socialiste. Le PS concède toutefois l’abandon des programmes contestés du Pellerin et de Plogoff ainsi qu’un débat parlementaire très consensuel à l’automne 1981. Signe de cette évolution, Huguette Bouchardeau devient secrétaire d’État à l’environnement en 1983, une forme de caution du tournant, mais fait adopter une loi rendant obligatoires les enquêtes publiques avec évaluation environnementale pour tout projet d’envergure.
Une situation en réalité assez peu contrastée aujourd’hui
Si l’opposition au nucléaire civil subsiste aujourd’hui chez les Verts et la France insoumise, au début des années 1980, elle semble avoir presque disparu, surtout lorsqu’on regarde ce qu’il se passe à la même époque dans les autres pays occidentaux, y compris aux États-Unis.
Joue également un certain soutien populaire à l’atome, nourri par des campagnes de sensibilisation d’EDF. Ainsi, Three Mile Island interrompt les projets américains et l’accident de Tchernobyl est fatal au programme allemand. Lors de la présidentielle de 1988, à peine deux après ce dernier, seuls le communiste dissident Pierre Juquin et le candidat des Verts (parti créé en 1984), Antoine Waechter, demandent l’arrêt du nucléaire après référendum. Ils recueillent cependant chacun moins de 5 % des suffrages. Le contexte est aussi celui d’une image pacificatrice de l’atome alors que l’Occident a déployé des missiles pour équilibrer des armes soviétiques à moyenne portée dans la crise des euromissiles : discours de force dans lequel la parole de Mitterrand a pesé et qui aboutit à un accord de démantèlement de toutes ces armes en Europe en 1987.
Il faut ensuite un renforcement des écologistes dans les années 1990 et l’arrivée au pouvoir de « la gauche plurielle », coalition où socialistes et communistes ne sont pas majoritaires à eux seuls, pour obtenir en 1997 l’arrêt de Superphénix connaissant de nombreux incidents. Le débat est surtout relancé par l’accident de Fukushima en 2011 ainsi que par la médiatisation du modèle allemand, dont la coalition rouge-verte de 1998 choisit la sortie du nucléaire.
Après la catastrophe japonaise, l’émotion est forte et des voix s’expriment jusqu’à l’extrême droite pour limiter le nucléaire. François Hollande promet alors en 2012 l’arrêt de la plus ancienne centrale, Fessenheim, et l’objectif de 50 % d’électricité nucléaire au lieu de 75 % environ.
Mais le rejet de plus en plus important de la transition énergétique et notamment des déploiements d’éoliennes ainsi que la crise consécutive à l’invasion de l’Ukraine ont balayé tous ces projets, le PS ne parlant plus que de promotion des énergies renouvelables. Les Verts restent fidèles à leur histoire quant à la France insoumise créée pour porter Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République en 2017, elle promet dès ses origines la sortie du nucléaire. Héritière des contestations d’extrême gauche à l’heure de l’inquiétude climatique, elle souhaite attirer l’électorat écologiste, ce qui peut expliquer ce positionnement alors qu’il n’est pas question d’abandonner la dissuasion nucléaire.
Qualifier la gauche française de foncièrement antinucléaire est dès lors une négation de son histoire post-1945.
L’évolution récente provient de l’émergence d’une nouvelle force assez puissante, la France insoumise, ayant adopté cette posture. Toutefois, sa gouvernance et certains de ces choix représentent aujourd’hui d’importants repoussoirs auprès d’un électorat de gauche modéré. Elle n’est donc pas représentative de l’opinion de gauche dans son ensemble et ne l’est pas non plus en ce qui concerne le nucléaire. Selon un sondage réalisé auprès de plus de mille personnes en 2022, 66 % des électeurs de gauche sont favorables à l’énergie nucléaire. Dans le détail, ils sont 56 % parmi les sympathisants de La France insoumise, 83 % chez les électeurs socialistes, et 53 % du côté des Verts. En ne revenant pas sur les politiques nucléaires en cours, le programme du Nouveau Front populaire le démontre car ne rien changer, c’est accepter.
Ce qui a en fait surtout changé, ces dernières années c’est que l’atome est devenu un argument, voire un étendard, de droite et d’extrême droite dans leur choix de séduire l’électorat rural et populaire par un discours anti-écologiste.
Yannick Pincé Chercheur associé CIENS ENS-Ulm et ICEE Université Sorbonne Nouvelle, École normale supérieure (ENS) – PSL
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original sur The Conversation.